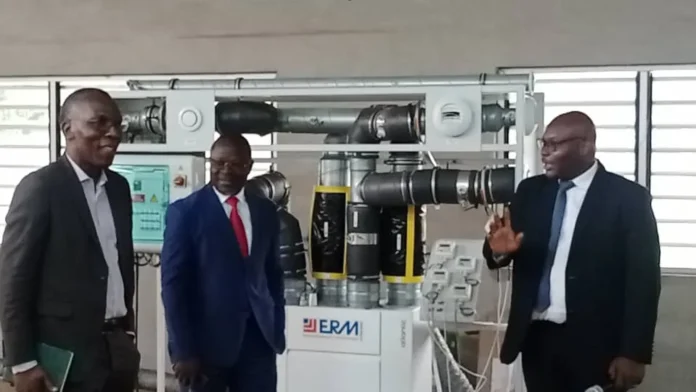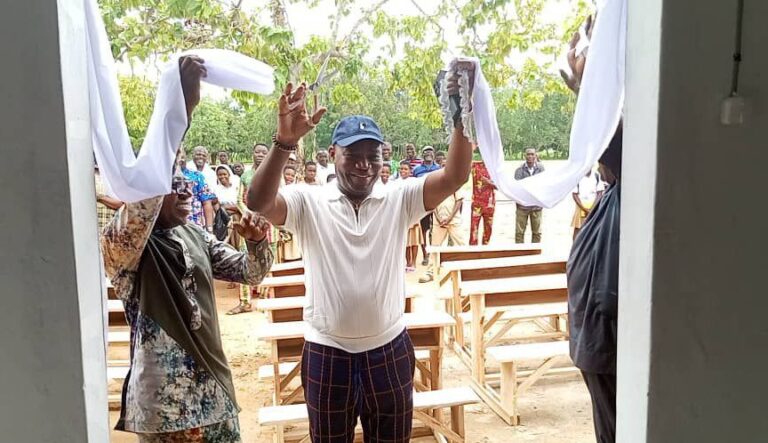Le système éducatif togolais se trouve aujourd’hui à un tournant décisif. À l’instar de nombreux pays africains, le Togo subit de plein fouet une pression démographique intense. Cette croissance exponentielle de la population scolaire engendre une demande massive en infrastructures, en personnel qualifié et en ressources pédagogiques. Conscient de l’enjeu, le gouvernement affiche une volonté politique affirmée pour étendre et rendre plus équitable l’accès à l’éducation.
Création de nouveaux établissements, recrutement de près de 5000 enseignants cette année, distribution de manuels, extension des cantines scolaires, programme de construction de 15 nouvelles salles de classe : les mesures sont là, tangibles. Mais ces efforts, aussi louables soient-ils, peinent à combler les besoins colossaux du terrain.
- Des avancées réelles, mais insuffisantes
Dans de nombreuses régions, l’ouverture de nouvelles écoles se heurte à des limites structurelles. Les conditions d’accueil demeurent précaires, et les distances imposées aux enfants, parfois âgés de moins de 11 ans, deviennent un véritable casse-tête sécuritaire et social. À cela s’ajoutent les défis du secondaire, avec des élèves admis au BEPC dès 11 ou 13 ans, trop jeunes pour affronter les réalités d’un cycle long, coûteux et géographiquement éloigné.
Le paradoxe est criant : alors que le système pousse vers la réussite, il en oublie parfois les conditions réelles de cette réussite.
- Les filles, premières victimes de cette équation inégalitaire
Dans ce contexte, les jeunes filles sont les premières à subir les effets pervers du système. Éloignement des établissements secondaires, insécurité sur les trajets, mariages précoces, pression socioculturelle : les obstacles à leur scolarisation sont multiples et persistants. Nombre d’entre elles sont déscolarisées sous couvert de « protection », sacrifiées au nom d’une tradition qui freine encore l’émancipation féminine.
Cette réalité annule, dans les faits, les effets des politiques de promotion de la scolarisation des filles. Le contraste est fort entre les engagements nationaux et les vécus des familles.
- Gouverner, c’est agir sur le réel
Le dilemme est désormais clair : faut-il attendre des écoles parfaites ou agir dès maintenant, avec les moyens disponibles, pour répondre à une urgence sociale criante ? Reporter l’action en espérant un idéal souvent inaccessible revient à condamner une génération entière.
La réponse, selon de nombreux experts, doit s’ancrer dans le pragmatisme : construction d’écoles en matériaux provisoires, dotation minimale en manuels, adaptation des horaires aux réalités locales, allègement des programmes, valorisation de l’excellence. Autant d’initiatives qui, sans être parfaites, peuvent amorcer un véritable tournant éducatif.
Mais pour que ces actions soient efficaces et acceptées, elles doivent s’inscrire dans une vision claire, durable et évolutive.
- Une volonté politique à transformer en choix courageux
Le gouvernement a posé les premiers jalons d’une réforme éducative d’envergure. Mais l’heure est désormais à l’amplification et à la consolidation. Une politique éducative réussie passe par des choix audacieux : rapprocher les écoles des communautés, garantir la sécurité des élèves, notamment des filles, et adapter les programmes aux contraintes socio-économiques des familles.
En somme, l’éducation ne peut plus être perçue comme un luxe ou un projet à long terme. Elle constitue une urgence nationale, un impératif moral et un pilier fondamental de la gouvernance. Offrir à chaque enfant togolais une éducation accessible, sûre et de qualité est plus qu’un droit : c’est un devoir.